Mentre celebriamo il quattrocentesimo anniversario della nascita di Blaise Pascal, un evento che ha già suscitato diversi scritti dedicati alla sua opera, Pierre Manent ci offre un approccio originale in un libro in cui ci fa sentire la voce di Pascal in risonanza con le nostre domande attuali, un libro non su Pascal, ma con lui.
À propos de
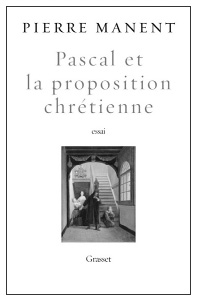
P. Manent, Pascal et la proposition chrétienne, Paris, Grasset, 2022, 14x20, 425 p., 24,00 €. ISBN 978-2-246-83236-2.
Alors que nous célébrons les quatre cents ans de la naissance de Blaise Pascal et que cet événement a déjà suscité plusieurs écrits consacrés à son œuvre, Pierre Manent propose, dans une approche originale, un livre dans lequel il nous fait entendre la voix de Pascal en résonance avec nos questions actuelles, un livre, non pas sur Pascal, mais avec lui. L’auteur, connu pour son œuvre de philosophie politique et un récent livre remarqué, Situation de la France, veut avec « l’aide et l’appui de Pascal » poser la « question la plus personnelle », à savoir la question chrétienne et interroger la raison de son effacement dans nos sociétés contemporaines. Or la question de Manent résonne justement avec l’entreprise pascalienne qui, par sa confrontation avec le libertin et le début de l’athéisme, cherche à reformuler la « proposition chrétienne ». De sorte que la « proposition chrétienne » du titre est à entendre tout autant de Pascal que de Pierre Manent.
L’ordre des chapitres du livre poursuit donc une démarche propre à son auteur, tout en retrouvant, peut-être sans le savoir, un ordre assez proche de celui des liasses des Pensées et du projet d’apologétique de Pascal. Cet ordre est traversé par l’interrogation de Manent sur l’élaboration de l’État et de la société moderne au mitan du xviie, et c’est sans doute cette visée qui donne à l’ouvrage son originalité tout en permettant d’entendre Pascal de manière contemporaine. Nous présenterons l’ouvrage selon son ordre tout en y relevant les points originaux et les questions qu’il peut susciter.
I Jésuitisme et jansénisme
C’est bien la question de l’athéisme qui ouvre le livre dès l’introduction et le premier chapitre (« Devant l’athéisme »), où s’énonce de manière claire la thèse qui commande la démarche de l’auteur : l’athéisme que Pascal voit naître autour de lui et qui règne aujourd’hui, est lié à l’avènement de l’État souverain comme « autre Église », pas seulement séparé de l’Église, mais au-dessus d’elle, ayant attiré à lui toute l’autorité et devenu « l’Église des volontés humaines séparées ». C’est à travers ce prisme que Manent replace la querelle entre jésuitisme et jansénisme en s’aidant du Pascal des Provinciales. Le jésuitisme serait la tentation « politique » de l’Église qui, dans une forme de progressisme, chercherait à adapter la morale à la société et à sa quête de liberté. Le jansénisme serait l’effort pour rappeler la transcendance des commandements de Dieu, le dogme du péché originel et la nécessité du salut, non sans la tentation inverse de se constituer en parti jusqu’à vouloir doubler l’Église. Si la thèse est pertinente dans une perspective d’histoire des idées politiques, ne force-t-elle pas toutefois le trait d’un Pascal janséniste en minorant la part de polémique et de caricature des Provinciales ? Sans doute, l’évolution de Pascal lui-même pourrait-elle contrebalancer cette approche, lui qui apprit progressivement de son étude de l’homme à tenir ensemble les « contrariétés » jusqu’à préparer le projet le moins janséniste qui soit, celui d’une apologétique.
Toutefois la thèse d’un avènement du règne de l’homme permet de replacer l’entreprise pascalienne avec ses enjeux. Car c’est bien de l’homme que Pascal part, c’est cet homme qu’il cherche à rejoindre, cet homme à qui peut s’adresser la « proposition chrétienne » parce que d’abord cette proposition est celle de « Dieu qui vient à l’homme ».
C’est pourquoi Manent explore dans les deux chapitres suivants (« Comment Dieu vient à l’homme » et « Prouver Dieu ? ») la manière dont Dieu vient à l’homme et celle dont Pascal cherche à susciter la réponse humaine. L’auteur commence par un commentaire de l’argument du pari, dispositif visant selon lui à mobiliser la volonté et non seulement la raison. Il rejoint ainsi les récents travaux de Laurent Thirouin1 qui veut voir dans l’argument du pari, l’essentiel de Pascal. Si Pascal rejette en effet les preuves rationnelles de Dieu, c’est qu’elles sont incapables de mouvoir la volonté et que de plus, Dieu se propose comme vie et non pas seulement comme notion intelligible. Dans cette perspective on regrettera d’autant plus que l’auteur estime que la seconde partie du pari est un raisonnement calculatoire inutile, alors que justement, il y a là, à partir du calcul des espérances de gain, tout un dispositif pour inciter la volonté en quête de bonheur. Car le projet du pari n’est pas de nous faire croire mais de nous donner à espérer. Malgré cette limite, il est certain que Manent touche juste sur la question de la volonté humaine comme réponse à la proposition chrétienne. Le rapprochement qui suit avec la preuve de saint Anselme est à cet égard très suggestif : dans les deux cas, les « preuves » sont des épreuves qui veulent susciter en nous un rapport actif à Dieu, à partir du dynamisme de l’esprit, pour Anselme, de celui de la volonté, pour Pascal.
II Les hommes tels qu’ils sont et les trois ordres
D’où avec ce dernier, le recentrement sur le phénomène humain opéré par Manent dans les deux chapitres suivants (« Le phénomène humain » et « Force et justice de l’ordre »). En partant de la distinction des trois ordres (l’ordre de la chair, l’ordre de l’esprit, l’ordre de la charité) avancée par Pascal, Manent propose une relecture audacieuse des grands bouleversements politico-religieux de la modernité. Alors que l’ordre de l’esprit et celui de la charité étaient alliés pour maintenir la concupiscence de la chair dans ses limites, voici que le monde moderne, depuis Galilée et l’invention de la science moderne, s’édifie par l’alliance de la science et de la concupiscence contre l’ordre de la charité. Pourtant Pascal, et Manent à sa suite, rappellent que l’ordre de l’esprit ne peut se suffire et que, bien au contraire, il fait buter l’homme contre ses propres limites. C’est l’homme qui est le grand mystère et son étude ne peut être tirée du rationalisme moderne, mais doit faire l’objet d’une discipline indépendante, fondée elle aussi sur l’expérience, celle de la condition humaine. Manent nous fait remarquer ici à quel point Pascal est physicien plus que géomètre, en homme attentif aux faits et qui veut leur soumettre la raison. Il le sera donc dans son étude de l’homme où il cherchera la « raison des effets », pour rendre compte des contrariétés qui habitent l’homme et sur lesquelles son esprit le fait s’interroger. L’homme étant indissociablement individuel et social, son étude conduit Pascal à une analyse de la contrariété de la force et de la justice comme se soutenant mutuellement pour rendre la société possible. Manent nous aide à saisir la perspective originale de Pascal en la confrontant à la tentative de Hobbes de fonder rationnellement l’État moderne, à partir d’un hypothétique état de nature. Car Pascal part des hommes tels qu’ils sont, à savoir guidés par l’amour propre, et montre l’effet bénéfique de la concupiscence de chacun et de tous sur la société, comme permettant de construire un « tableau de charité » dans lequel l’intérêt de chacun conduit à l’échange de biens pour tous. La reprise des catégories pascaliennes du « peuple », des « demi-habiles », des « habiles », des « dévots » et enfin des « chrétiens parfaits », permet alors à Manent une relecture originale de l’avènement de la démocratie comme victoire des « demi-habiles », qui ont critiqué l’ordre social au nom de l’égalité et des mérites, oubliant qu’elle était la porte ouverte à la guerre civile. Plutôt que l’habile qui, par une « pensée de derrière », utilise le système à son profit, plutôt que le dévot qui méprise la société et veut christianiser la vie publique, il faut être un « chrétien parfait », c’est-à-dire commencer par regarder sa propre injustice. Car la grâce et le péché sont inséparables dans l’ordre humain. C’est donc bien à une science expérimentale qu’il faut recourir. Mais une science qui soit personnelle et pour cela, il faut partir du « Moi ».
III L’homme et le fait du Christ
D’où l’étude, dans les chapitres suivants (« Les illusions du moi » et « Grandeur et misère »), des contrariétés de l’homme, en particulier de sa grandeur et de sa misère. L’homme est prisonnier de son amour propre. C’est sa volonté qui est esclave. L’homme le sent mais il hait cette vérité. Seul le dogme du péché originel peut expliquer cette contrariété. Manent souligne le contraste avec la pensée de Rousseau qui cherche l’explication de l’injustice humaine du côté de l’inégalité de la société et pose, à l’origine, un amour de soi indifférent au mal et au bien que la volonté peut ensuite mobiliser dans un sens ou dans l’autre. Mais comment accorder amour de soi et amour universel ? Rousseau ne peut fonder un moi commun à partir des moi individuels. Seul le pourrait le mystère d’un corps où, en s’aimant comme membre du tout, chacun pourrait s’aimer soi-même de manière juste (ce sont les développements de Pascal sur la morale chrétienne dans l’avant-dernière liasse des Pensées).
L’importance donnée par Pascal au dogme du péché originel comme permettant de rapporter la grandeur et la misère de l’homme, à deux états de sa nature (l’homme créé juste et l’homme né injuste), permet à Manent un développement sur l’objectivité et le caractère impératif pour la foi du dogme chrétien. C’est bien là que le paradoxe se redouble puisque seul le dogme peut nous révéler à la fois notre péché et Celui qui nous en libère, tout en étant impuissant à nous faire croire. Les pages pascaliennes à propos du divertissement montrent cette insensibilité profonde de l’homme à sa misère et plus encore à la question de son sort. C’est à cette insensibilité qu’il faut rendre le libertin sensible, car il y a là un « assoupissement surnaturel », qui témoigne justement de la vérité du dogme. L’auteur ici souligne la force de la stratégie pascalienne : il ne s’agit pas tant de convaincre par le dogme que de faire sentir à l’homme la vérité existentielle du dogme par l’« expérience » de sa propre indifférence à son sort, afin de lui permettre d’accueillir le libérateur.
Après avoir ainsi acculé l’homme à sa contradiction, Manent nous introduit avec Pascal au Libérateur (il s’agit des chapitres « Libérateur et médiateur » puis « Le style de l’Évangile »). Là encore Pascal pense en homme attentif aux faits. Il s’agit bien, ainsi que le porte le titre d’une des liasses, des « Preuves de Jésus-Christ ». Or celles-ci sont de deux sortes et se soutiennent mutuellement : en effet - ainsi que le résume Manent – « le fait du Christ est inséparable du fait juif ». Ce point qui s’enracine dans l’herméneutique des Pères de l’Église, en particulier chez saint Augustin, est repris de manière neuve par Pascal : il y a une preuve rationnelle du Christ dans le fait que les prophéties annoncent que le peuple juif ne reconnaîtra pas son Messie, ce qui fait des Juifs des témoins non-suspects, et de l’accomplissement des prophéties, les seules preuves valables de Jésus-Christ (et non les miracles). L’argument est ici non pas théologique mais seulement humain. C’est ce point que retient Manent comme pertinent pour notre temps : il y a un « apparaître » paradoxal de Jésus-Christ antérieur à la foi, qui doit être pris en compte dans la perspective d’une apologétique. Il faut donc mettre les prophéties en relation avec la figure du Christ et son « apparaître ». Manent est attentif à l’insistance de Pascal sur la modestie des historiens évangéliques qui osent peindre l’humilité et la faiblesse du Christ dans son agonie, afin de montrer comme Jésus est venu dans l’éclat de son ordre, celui de la charité.
Arrivé à ce point, Manent s’écarte des Pensées pour scruter le beau texte de Pascal sur le Mystère de Jésus. Ce texte qui est principalement une méditation sur le mystère de l’agonie n’entre pas dans le projet apologétique comme tel. Si Manent le retient, c’est qu’il lui permet de creuser le contraste entre l’héroïsme de Jésus-Christ dans sa Passion et sa faiblesse humaine dans l’agonie. Étonnamment, l’auteur s’éloigne de Pascal dans son interprétation de Gethsémani. Que nous dit Pascal ? Que Jésus craint la mort. Que nous dit Manent ? Que voir dans le tourment de Jésus la crainte de la mort, c’est donner une interprétation trop psychologique sans voir que ce trouble, entièrement lié à sa « mission divine » porte, non sur la mort, mais sur le fait d’être livré au pouvoir des ténèbres et de devoir accepter la victoire de Satan en « rétractant sa bonté toute-puissante », jusqu’à endurer la contradiction des pécheurs.
Cette interprétation est assez fascinante dans la mesure où elle place l’angoisse de l’agonie dans la Personne divine elle-même, comme angoisse devant la damnation possible de certains. Elle demanderait à être nuancée, tout d’abord parce qu’il semblerait plutôt que la coupe soit reçue justement comme le moyen de sauver de la damnation, en acceptant de prendre la place des pécheurs. Enfin elle semble minorer la nature et la volonté humaine du Christ au prix d’une accentuation sur sa volonté une en laquelle sont unies volonté humaine et volonté divine. Or ce point est capital dans la tradition de l’Église et la christologie : c’est celui des deux volontés, humaine et divine, du Christ, distinctes et non confondues, qui fait l’essentiel de l’analyse de St Maxime le Confesseur. Cette dernière donna lieu aux définitions du Latran et de Constantinople iii qui achevèrent la christologie de Chalcédoine. L’enjeu est sotériologique : en voulant humainement la volonté divine de notre salut, selon l’obéissance filiale qui lui est propre, le Christ sauve la volonté humaine. C’est aussi ce qui fait l’extrême de son angoisse, car ce n’est pas en simple homme qu’il a éprouvé la frayeur, mais dira Maxime, « selon un mode qui nous dépasse », parce qu’il est le Fils et le Prince de la Vie. En tremblant devant la mort, le Christ honore pleinement la volonté humaine ordonnée à la vie et au bonheur, et l’assume à l’intérieur de son obéissance au Père pour accepter la mort et y rejoindre nos ténèbres.
Cette précision permet peut-être de mieux voir comment l’enjeu christologique est aussi un enjeu anthropologique. Car si le libre arbitre peut coopérer à la grâce, c’est bien parce que, dans le Christ, la volonté humaine a été sauvée et rendue capable de vouloir et accomplir la volonté de Dieu. N’est-ce pas ce défaut de christologie qui a empêché le xviie siècle français de penser l’entière coopération du libre arbitre à la grâce2 ? En cherchant à établir les parts de la volonté humaine et de la volonté divine dans le salut, on en restait à une opposition entre nature et grâce. Pascal dans son Mystère de Jésus, a justement contemplé ce mystère de l’agonie et retrouvé, avec d’autres, la grande Tradition de l’Église. Telle est peut-être l’œuvre de conversion qui s’est opérée en lui et l’a conduit, par la contemplation de Jésus-Christ, à s’éloigner du jansénisme et de sa vision binaire du salut opposant nature et grâce, jusqu’à pouvoir dire : « Je ne suis pas de Port-Royal. »
IV Face à l’athéisme contemporain, montrer la douceur du Christ
C’est en tout cas sur ces questions de la grâce et de la liberté que Pierre Manent achève son ouvrage (« La certitude et le salut », puis « Conclusion : la crainte et la joie ») en essayant de tempérer les écrits de Pascal sur la grâce à l’aune d’une vision plus globale et plus contemporaine du dessein bienveillant de Dieu pour notre salut. Il y a tout d’abord le constat terrible du fait que l’enjeu d’un choix engageant notre éternité (et même simplement notre vie) n’est plus perçu par l’homme contemporain. D’où le recours à Pascal qui a perçu cette indifférence des libertins et qui cherche par un parcours original, d’où la raison n’est point absente, à conduire celui-ci à un choix du cœur. Face à l’athéisme pratique, face à la « réluctance » humaine au christianisme, il faut montrer la douceur du Christ qui définit la conduite de Dieu à notre égard. Seule cette « grâce » peut à la fois faire sentir à l’homme son amour-propre et Celui qui peut l’en guérir. Mais Dieu est justement caché. Il aveugle les uns par son obscurité et éclaire les autres par sa bonté. C’est sur ce point que Pascal était obligé d’épouser les limites de l’augustinisme de son temps, en affirmant la nécessité d’une grâce efficace. L’homme qui se perd, montre que sa volonté a déjà choisi et qu’il s’est refusé à la grâce. Il est alors juste qu’il rejoigne la « masse de perdition », car Dieu entérine alors son propre choix. Mais qu’est-ce qui explique le « premier délaissement de Dieu » par lequel l’homme s’est refusé ? Pour Pascal, cela reste « mystérieux est incompréhensible ». Pierre Manent montre ici de manière judicieuse la limite de Pascal en relevant la séparation ruineuse entre la question de la grâce et l’économie du salut. De sorte que la question du salut est envisagée de manière trop individualiste sans que l’humanité soit comprise comme un tout, et surtout dans une histoire d’alliance avec Dieu où la possibilité laissée au péché est intégrée dans le dessein bienveillant de Dieu.
V Approfondir la théologie de la grâce
Tout en se démarquant d’une théologie de la grâce trop étroite, Manent ne va pas à mon sens au bout de l’insertion de la grâce dans la perspective de l’histoire du salut, en particulier en n’évoquant pas l’histoire de la liberté de chacun. Car l’espérance d’être sauvé n’est pas seulement l’envers de « la crainte de l’enfer », elle n’est pas seulement le terme mais le fondement d’une vie nouvelle reçue au baptême et qui est appelée à se déployer en charité à travers une histoire de péché et de pardon, ordonnée à la divinisation même de l’homme. Sinon, on risque d’en rester à la vision janséniste figée des deux états (avant le péché et après le péché) de sorte que dans le second état, il faut que la grâce soit une « délectation toute-puissante » pour sauver l’homme, grâce qui est alors séparée de la liberté humaine. Il est à cet égard regrettable que le xviie siècle et Pascal avec lui, aient quelque peu oublié la tradition spirituelle du discernement des esprits, pourtant revivifiée un siècle avant par saint Ignace, au profit d’une compréhension purement morale de l’homme en termes de passions subies et de vertus acquises. En restreignant le champ du combat spirituel dans l’homme lui-même, il se condamnait à comprendre la grâce de manière extrinsèque comme si elle n’était là que pour permettre à la nature humaine d’exercer les vertus en vue de son salut. Bien loin d’épouser le libre-arbitre dans une histoire « sainte », la grâce le forçait. Ainsi comprise sous la forme du tout ou rien, cette vision de la grâce faisait peser sur l’homme l’angoisse d’un choix absolu pour le ciel ou pour l’enfer que seul l’ange dans sa science éternelle était appelé à poser.
Dieu merci, notre liberté n’est pas celle de l’ange. Parce que nous sommes sauvés en espérance, notre liberté est appelée à s’engager à la suite du Christ et à collaborer à l’œuvre divine pour le salut de tous. Cette « synergie » que Pascal a entrevue car elle était contenue dans la christologie des Pères de l’Église, est trop peu développée par Pierre Manent alors qu’elle est aussi à mon sens ce que notre vie chrétienne doit redécouvrir pour répondre aux défis de l’athéisme de notre temps.
Celui-ci se caractériserait selon Manent par le primat de l’amour du prochain qui nous dispense d’aimer Dieu et qui a conduit nos sociétés démocratiques à développer les valeurs d’égalité en s’appuyant sur le sentiment naturel de compassion des hommes entre eux. Mais nos sociétés ont oublié la misère de l’homme, et son injustice fondamentale. Selon lui, la force de Pascal est de nous obliger à commencer par Dieu en butant sur notre propre contrariété révélée dans le dogme du péché originel afin de nous tourner vers le Médiateur. Sans lui pas d’amour du prochain réel. Nous sommes ainsi à la fois, en Adam, soumis à la concupiscence et, en Jésus-Christ, rachetés et sauvés en espérance, capables d’aimer notre prochain comme nous-même, en tant que « membre d’Adam et membre de Jésus-Christ ». Arrivé à ce point, Pierre Manent peut, à partir de Pascal, approfondir l’action chrétienne appelée par la grâce : celle-ci n’est pas seulement la « continuation de la prière » pour continuer à recevoir la grâce, elle n’est pas seulement la joie d’avoir trouvé Dieu, mais elle est cet amour de soi et d’autrui comme membre du même corps du Christ dont parle Pascal dans la liasse « Morale chrétienne ». Lorsque ce dernier écrit à Mlle de Roannez qu’il ne se séparera « jamais de sa communion », il ne s’agit pas d’abord de la communion avec Dieu qu’il faut demander constamment par la prière, mais de la communion de l’Église où s’unissent les deux commandements de l’amour. N’est-ce pas ce qu’indiquent de manière fulgurante les deux citations écrites par Pascal dans son Mémorial et rappelées par Manent à la fin de son livre :
Deum meum et Deum vestrum
Ton Dieu sera mon Dieu.
La joie de connaître Dieu devient alors, ainsi que le souligne l’auteur, la joie d’être uni à ses frères par Jésus-Christ et de partager avec eux le même Père.
Au terme de l’ouvrage, nous sommes reconnaissants tout à la fois à l’homme et au philosophe de nous avoir livré une lecture aussi personnelle et originale de Pascal. Le dialogue initié dans ces pages en laisse augurer la fécondité.
